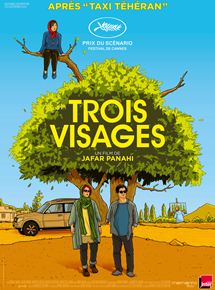 Drame écrit, réalisé et joué par Jafar Panahi. En sélection officielle au Festival de Cannes, il a reçu le Prix du scénario.
Drame écrit, réalisé et joué par Jafar Panahi. En sélection officielle au Festival de Cannes, il a reçu le Prix du scénario.
La comédienne iranienne Behnaz Jafari, dans son propre rôle, reçoit via instagram la vidéo (première mise en abyme) d’une jeune fille de la campagne iranienne qui se pend en direct dans une grotte, métaphore de l’obscurité/l’obscurantisme. Motif : ses parents ne veulent pas qu’elle devienne actrice. Vraie vidéo ou manipulation ? Un brin borderline, Behnaz demande à son ami Panahi, le réalisateur lui-même, de l’accompagner sur le lieu de la tragédie.
Un peuple schizo
Ils découvrent qu’il s’agit d’un mensonge, un appel au secours. L’ado ne s’est pas suicidée mais elle est frustrée, empêchée de vivre sa vocation, exactement comme Panahi, interdit de tourner dans son pays. Dénonciation d’un peuple schizo qui aspire à la liberté tout en imposant au pouvoir des censeurs fondamentalistes ?
Enkystés dans une malédiction
Un taureau couché en travers de la route (symbole de virilité, thème récurrent) empêche nos deux célébrités de rentrer chez eux. Coincées dans ce village, comme enkystés dans une malédiction, ils vont l’arpenter et faire d’improbables rencontres. L’occasion d’évoquer l’Iran, ses traditions, sa méfiance vis-à-vis des urbains, sa dramatique religion, son régime patriarcal mais aussi l’hospitalité de certains habitants. En arrière-plan, une vision de la place des artistes dans ce pays. Certaines scènes sont truculentes : les villageois reconnaissent la comédienne mais s’en détournent quand ils comprennent qu’elle est progressiste ; un vieux père leur confie le prépuce, conservé dans du sel, de son fils pour le remettre à un acteur.
3 générations
Le récit prend son temps, délicieusement. Et le réalisateur rend hommage ça et là à son mentor, Kiarostami, dont il fut l’assistant (Où est la maison de mon ami ou Le Goût de la cerise). Il dépeint en particulier 3 visages, 3 femmes, 3 beaux portraits, 3 générations : l’héroïne, la jeune fille dont on a coupé les ailes, et une vieille actrice du temps du shah, bannie et recluse, qui danse encore, pourtant, dans l’intimité de sa modeste cabane et dont on ne verra jamais le visage, d’ailleurs.
Voir la bande-annonce, cliquez ici

 Everybody knows
Everybody knows 
 L’amant d’un jour de Philippe Garrel, présenté à La Quinzaine des réalisateurs à Cannes où il a obtenu le prix SACD (Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques) ex-aequo avec Un beau soleil intérieur de Claire Denis.
L’amant d’un jour de Philippe Garrel, présenté à La Quinzaine des réalisateurs à Cannes où il a obtenu le prix SACD (Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques) ex-aequo avec Un beau soleil intérieur de Claire Denis. Sélectionné au Festival de Berlin,
Sélectionné au Festival de Berlin,  Continuer de Laurent Mauvignier. Le verbe à l’infinitif donne la tonalité du récit. L’auteur nous propose un voyage initiatique, cinématographique, un roman d’aventure et d’amour.
Continuer de Laurent Mauvignier. Le verbe à l’infinitif donne la tonalité du récit. L’auteur nous propose un voyage initiatique, cinématographique, un roman d’aventure et d’amour. 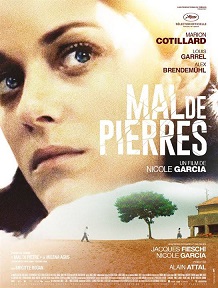
 La fille inconnue des frères Dardenne. Comme Rosetta (Emilie Dequenne) en quête d’un job, Samantha (Cécile de France), la coiffeuse qui ne voulait pas abandonner le gamin à vélo, Sandra (Marion Cotillard) qui sonnait chez ses collègues pour les persuader de renoncer à leur prime et lui permettre de garder son emploi, voici Jenny (Adèle Haenel), une jeune médecin. Encore un beau portrait de femme-courage.
La fille inconnue des frères Dardenne. Comme Rosetta (Emilie Dequenne) en quête d’un job, Samantha (Cécile de France), la coiffeuse qui ne voulait pas abandonner le gamin à vélo, Sandra (Marion Cotillard) qui sonnait chez ses collègues pour les persuader de renoncer à leur prime et lui permettre de garder son emploi, voici Jenny (Adèle Haenel), une jeune médecin. Encore un beau portrait de femme-courage. Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Je ne suis pas fan du théâtre filmé. Pourtant, le huis clos est ici bien assumé comme dans « Tom à la ferme », (le film est tiré de la pièce éponyme de Lagarce, écrite en 1990, légèrement datée). Un jeune écrivain, malade (Gaspard Ulliel) rentre dans sa famille après douze ans d’absence, pour annoncer sa fin prochaine. Et n’y arrive pas. Toutes les névroses familiales se rejouent, les frustrations de chacun s’exacerbent, les jalousies fratricides. Une dernière fois. Chacun parle beaucoup pour cacher l’essentiel. On retrouve la honte de soi et le déni, motifs qui infusent tous les films de Dolan.
Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Je ne suis pas fan du théâtre filmé. Pourtant, le huis clos est ici bien assumé comme dans « Tom à la ferme », (le film est tiré de la pièce éponyme de Lagarce, écrite en 1990, légèrement datée). Un jeune écrivain, malade (Gaspard Ulliel) rentre dans sa famille après douze ans d’absence, pour annoncer sa fin prochaine. Et n’y arrive pas. Toutes les névroses familiales se rejouent, les frustrations de chacun s’exacerbent, les jalousies fratricides. Une dernière fois. Chacun parle beaucoup pour cacher l’essentiel. On retrouve la honte de soi et le déni, motifs qui infusent tous les films de Dolan.