
Mes patients, pour ainsi dire tous, ont un profil d’hyper-sensible/atypique, voire zèbre ou Haut-Potentiel (surdoué). Je suis toujours réticente à figer les personnes dans des cases (et en l’occurrence, ces patients-là détestent les cases), coller, d’emblée, des étiquettes. De plus, l’hyper-sensibilité est à la mode. Tarte à la crème de la psychothérapie. Mais une chose est certaine : il est essentiel de valider leur énorme potentiel, les accompagner à reconnaître, accepter et transformer leurs belles différences.
Xavier est mal dans sa peau. Il se sent en décalage dans son entreprise. « Lorsque je peux innover, je m’exalte quelques heures mais dès que la routine reprend le dessus, je m’ennuie terriblement. ». A mes yeux, Xavier n’est pas instable, il a simplement toujours besoin de nouveauté. Sa pensée « décroche » quand ses missions ne sont pas suffisamment complexes. Impossible de se concentrer sur les tâches trop faciles.
Travailler l’estime de soi
Marie est dyslexique. « Mes difficultés d’apprentissage ont détruit ma confiance en moi et dans le couple». Vulnérable, Marie a été manipulée par son mari qui lui a fait couper les liens avec son entourage. Les hypersensibles/atypiques sont facilement la proie des pervers narcissiques.
Albane est une éponge. Dans l’empathie absolue. Deux collègues se disputent ? Alors qu’elle n’est pas concernée, elle se sent prête à tomber dans les pommes. Nous analysons ensemble la « bonne distance » pour qu’elle ne s’identifie pas à des ressentis qui ne sont pas les siens. Elle est d’un perfectionnisme extrême. « Quand mon chef me félicite, j’éprouve un grand sentiment d’imposture. C’est certain, il va finir par s’apercevoir que je ne suis pas à ma place. Je ne mérite pas ce job, je n’ai pas fait d’études ». Albane est sa meilleure ennemie, dans la critique permanente, elle traque les failles, les siennes et celles des autres. On « bosse » sur ses valeurs par des exercices inspirés de la Thérapie d’Acceptation et d’Engagement (ACT). « Plus vous vous rapprocherez de ce qui vous rend réellement heureuse, plus vous trouverez votre vraie personnalité ».
Hélène est une écorchée vive, à fleur de peau. En permanence sur le fil. « Je me souviens mot pour mot de toutes les humiliations de mon enfance. Des faits qui sans doute étaient insignifiants pour mes copains de classe et qui pour moi me faisaient verser des torrents de larmes. Une réflexion sur mes cheveux frisés, sur ma timidité maladive, l’indifférence d’un camarade me blessaient terriblement ». Je lui demande de noter quand elle s’estime. C’est dur de parler de soi en positif ! Je l’invite à s’appuyer sur ses ressources dès qu’elle se sous-estime.
« Je ne suis bien qu’avec les rares personnes qui me ressemblent »
Claire se décrit trop fragile. En souffrance. Cela l’empêche de rentrer en relation avec les autres. Elle fuit les groupes, refuse des invitations et du coup, se sent seule et incomprise. Peur de trop ressentir ? « Je ne suis bien qu’avec les rares personnes qui me ressemblent. Il n’y a que les vrais liens qui me nourrissent, parler de la pluie et du beau m’exaspère». Au fil des rendez-vous, des actings en somato-thérapie et Gestalt l’incitent à se reconnecter à son schéma corporel, à ses blessures bien engrammées dans la cuirasse musculaire. Elle s’entraîne à reconnaître aussi la couleur et les nuances de la peur, de la colère, de la joie, de la honte, de la tristesse pour mieux lâcher prise. Je plaisante (en moitié) : « Sortez de votre carapace, cassez votre armure. Elle a été nécessaire pour vous protéger dans l’enfance mais elle ne l’est peut-être plus aujourd’hui ». Faire de ses émotions des alliées, comprendre à quels besoins elles correspondent s’apprend également.
« J’ai mille idées à la seconde. Cela me fatigue, me déprime »
Stéphane, hyper-émotif, écrit des chansons. Je m’emploie à lui faire prendre conscience de ses talents hors du commun. Etre hypersensible/atypique, c’est être créatif. C’est le bon revers de la médaille, non ? Il me confie sa scolarité défaillante : « J’étais nul en classe, le bon à rien et le bouc émissaire de toute l’école ». Je ne lâche rien : « Vos aptitudes n’ont sans doute pas été détectées ou votre environnement les a niées mais ce n’est pas trop tard ! » Beaucoup d’hyper-sensibles/atypiques ne respectaient pas le cadre scolaire. Leurs réflexions « trop » originales, fouillées, fantaisistes, voire provocatrices, déstabilisaient leurs professeurs et leurs parents.
Solenne est curieuse de tout, pige très vite, rassemble des infos sans les ordonner. Elle a du mal à choisir entre plusieurs solutions, procrastine. Fonctionne par fulgurances. Pourquoi ? Parce que probablement, son intelligence n’est pas linéaire mais en arborescence.
Elle a l’oreille fine, un simple bruit devient un vacarme. Impossible de se concentrer dans l’open-space ! Elle réagit à tous les stimuli : l’étiquette d’un vêtement qui frotte contre sa peau, une forte lumière… Tous ses sens sont exacerbés.
Un besoin de justice hors du commun anime Sophie. Sauver est sa raison d’être. On travaille sur le classique triangle « sauveur, bourreau, victime ». En discutant, je lui glisse que ses enfants, jugés hyper-actifs, semblent avoir des facilités, même si, très affectifs, ils ont besoin du regard aimant et valorisant de leurs profs pour réussir.
« Je suis un handicapé du langage »
Rémi, volubile, très fin dans ses raisonnements, affirme « je bégaie à l’intérieur de moi. Je suis un handicapé du langage ». Le cerveau de l’hyper-sensible/atypique intégrerait toutes les informations sans les trier. La parole a du mal à suivre le haut débit des images mentales et des associations d’idées débordantes. Rémi est considéré comme puéril par son entourage. Nous évoquons l’intelligence émotionnelle. Par des méditations sur « l’enfant intérieur », en particulier, il se réconcilie peu à peu avec ses ressentis passés. Il est particulièrement intuitif et je l’invite à creuser cette qualité.
« J’ai mille idées à la seconde. Cela me fatigue, me déprime, je suis irritable, je me demande si je ne suis pas bipolaire » se plaint Frédérique. Effectivement, l’hyper-sensible/atypique a des perceptions intenses, des réactions extrêmes, une pensée complexe, systémique. Et ils cultivent les paradoxes. Par exemple, malgré leur manque de confiance, ils peuvent avoir « réponse à tout » ce qui exaspère l’entourage et donc les marginalise.
Comme chez les surdoués, le nombre des connexions neuronales serait plus élevé et plus rapide que chez les gens « normaux ». « Vous êtes probablement en capacité d’analyser et de synthétiser un grand nombre de données en même temps. C’est épuisant en effet ! ».
Mais d’ailleurs, les hyper-sensibles/atypiques sont-ils surdoués/zèbres ?
Tous les surdoués sont hypersensibles mais pas forcément atypiques : ils peuvent être dans le moule, bien dans leurs baskets. Lorsqu’ils sont surdoués et atypiques, le terme de « zèbre » inventé par Jeanne Siaud-Facchin est bien approprié. C’est une belle métaphore : le zèbre n’est-il pas le seul animal sauvage que l’homme n’a pas pu domestiquer ? Ses rayures lui permettent de se dissimuler et chacun, cependant, se distingue par un pelage unique.
Les hypersensibles/atypiques ne sont pas forcément surdoués, c’est-à-dire n’ont pas nécessairement un QI aux alentours de 135. Peu importe ! Non seulement ils partagent pratiquement les mêmes caractéristiques, mais en plus, les protocoles pour les accompagner sont les mêmes.
La douance est validée
A mes patients hyper-sensibles/atypiques et potentiellement « zèbres », je conseille de lire les classiques : Alice Miller, Christel Petitcollin, Jeanne Siaud-Facchin, Elaine Aron, Cécile Bost, Nicolas Gauvrit, Saverio Tomasella, Valérie Foussier, Monique de kermadec, Raymonde Hazan, Nadine Kirchgessner… lorsqu’ils se reconnaissent, L’image qu’ils ont d’eux – même change radicalement. Leur vie aussi, du coup. La légitimité est salvatrice.
Ceux qui le souhaitent vraiment peuvent passer un test avec un psychologue habilité. (Là encore, la vigilance s’impose ! ) pour en « avoir le cœur net ». La douance est très souvent validée et les patients soulagés : Il existe une explication plausible à leurs troubles. Mais il est difficile de franchir le pas. N’est-ce pas prétentieux de s’auto-soupçonner surdoué ? (L’hyper-sensible/atypique, lucide sur tout ce qu’il ne sait pas, est en général modeste)…Attention, prendre en compte seuelment le QI est réducteur. On peut avoir une intelligence moyenne dans un domaine et supérieure dans un autre. Le bon test est celui qui permet de déterminer les points forts de chacun et considère toutes les intelligences.
Notes :
Les prénoms de mes patients ont été changés. Mais ils se reconnaîtront ici ou là…
Articles à venir :
- Le zèbre en entreprise
- Zébritude et résilience
- Tout le monde est zèbre à la naissance ?
 Berlin en deuil, le RER en rade, Alep, il n’y a jamais eu autant de réfugiés à faire la manche, des grappes d’enfants frigorifiés.
Berlin en deuil, le RER en rade, Alep, il n’y a jamais eu autant de réfugiés à faire la manche, des grappes d’enfants frigorifiés.



 Souvent, nous avons l’impression de subir ce qui nous arrive, d’être impuissant. Nous prenons alors une posture de victime. Déjà, les stoïciens, et ensuite Schopenhauer, croyaient en une sorte de force aveugle. Un peu comme la pulsion freudienne qui nous empêche de décider de notre sort (le schicksal/destin).
Souvent, nous avons l’impression de subir ce qui nous arrive, d’être impuissant. Nous prenons alors une posture de victime. Déjà, les stoïciens, et ensuite Schopenhauer, croyaient en une sorte de force aveugle. Un peu comme la pulsion freudienne qui nous empêche de décider de notre sort (le schicksal/destin).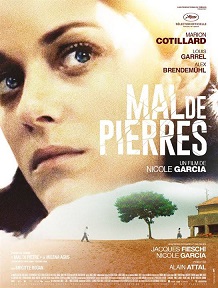
 La fille inconnue des frères Dardenne. Comme Rosetta (Emilie Dequenne) en quête d’un job, Samantha (Cécile de France), la coiffeuse qui ne voulait pas abandonner le gamin à vélo, Sandra (Marion Cotillard) qui sonnait chez ses collègues pour les persuader de renoncer à leur prime et lui permettre de garder son emploi, voici Jenny (Adèle Haenel), une jeune médecin. Encore un beau portrait de femme-courage.
La fille inconnue des frères Dardenne. Comme Rosetta (Emilie Dequenne) en quête d’un job, Samantha (Cécile de France), la coiffeuse qui ne voulait pas abandonner le gamin à vélo, Sandra (Marion Cotillard) qui sonnait chez ses collègues pour les persuader de renoncer à leur prime et lui permettre de garder son emploi, voici Jenny (Adèle Haenel), une jeune médecin. Encore un beau portrait de femme-courage. Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Je ne suis pas fan du théâtre filmé. Pourtant, le huis clos est ici bien assumé comme dans « Tom à la ferme », (le film est tiré de la pièce éponyme de Lagarce, écrite en 1990, légèrement datée). Un jeune écrivain, malade (Gaspard Ulliel) rentre dans sa famille après douze ans d’absence, pour annoncer sa fin prochaine. Et n’y arrive pas. Toutes les névroses familiales se rejouent, les frustrations de chacun s’exacerbent, les jalousies fratricides. Une dernière fois. Chacun parle beaucoup pour cacher l’essentiel. On retrouve la honte de soi et le déni, motifs qui infusent tous les films de Dolan.
Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Je ne suis pas fan du théâtre filmé. Pourtant, le huis clos est ici bien assumé comme dans « Tom à la ferme », (le film est tiré de la pièce éponyme de Lagarce, écrite en 1990, légèrement datée). Un jeune écrivain, malade (Gaspard Ulliel) rentre dans sa famille après douze ans d’absence, pour annoncer sa fin prochaine. Et n’y arrive pas. Toutes les névroses familiales se rejouent, les frustrations de chacun s’exacerbent, les jalousies fratricides. Une dernière fois. Chacun parle beaucoup pour cacher l’essentiel. On retrouve la honte de soi et le déni, motifs qui infusent tous les films de Dolan.

 Dans son roman (un peu) fourre-tout, entre conte, poésie, thriller, ultra référencé, « l’amour et les forêts », Eric Reinardt brosse avec justesse le portrait d’une femme en proie à la perversion de son mari.
Dans son roman (un peu) fourre-tout, entre conte, poésie, thriller, ultra référencé, « l’amour et les forêts », Eric Reinardt brosse avec justesse le portrait d’une femme en proie à la perversion de son mari.